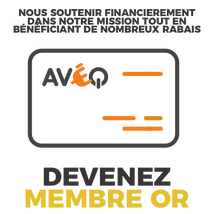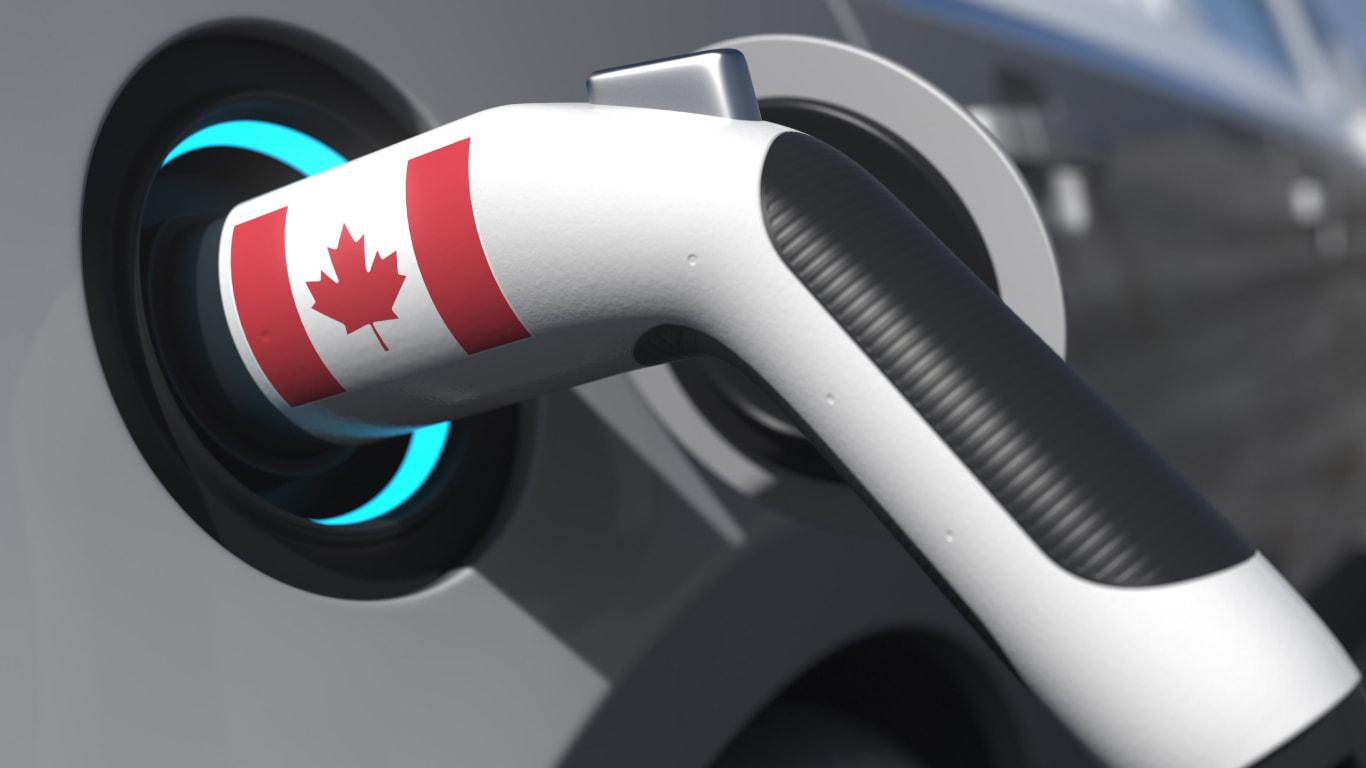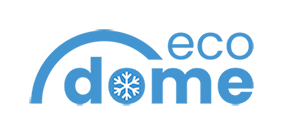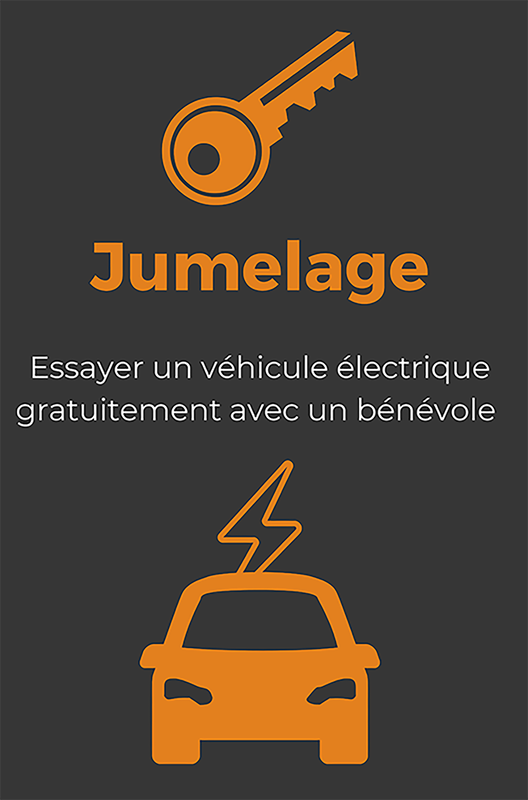|
En 2022, malgré les difficultés liées à la pandémie de COVID-19 et la pénurie de semi-conducteurs, les ventes de véhicules électriques (VÉ) à l’échelle mondiale ont représenté 14 % de toutes les véhicules vendus. Il s’agit d’une augmentation considérable par rapport à la part de marché de 9 % observée en 2021. Cette hausse, principalement attribuable à la Chine et l’Europe, a contribué à mettre en circulation plus de 26 millions de VÉ sur les routes. Les véhicules électriques à batterie (VEB) ont par ailleurs été à l’origine d’environ 70 % de cette croissance. Les chiffres observés à l’échelle mondiale ont ravivé l’intérêt pour une nouvelle norme récemment annoncée par le gouvernement du Canada, alors qu’il vise à améliorer les chaînes d’approvisionnement et les infrastructures liées aux VÉ au pays, ainsi qu’à effectuer une transition progressive vers l’abandon des combustibles fossiles. La réglementation exigera qu’au moins 20 % des véhicules neufs vendus au Canada soient à émission zéro d’ici 2026, au moins 60 % d’ici 2030 et 100 % d’ici 2035. La catégorie des véhicules à émission zéro (VZE) comprend les VEB et les véhicules hybrides rechargeables. Cette réglementation met en lumière non seulement l’importance économique que revêtent les VZE, mais souligne aussi le rôle essentiel qu’ils joueront dans l’atteinte des futures cibles en matière d’émissions et des objectifs d’électrification verte du Canada. Toutefois, l’abandon graduel des combustibles fossiles suscite une importante question : l’infrastructure énergétique du Canada est-elle prête à accueillir cette éventuelle vague de VZE? Tendances de la consommation énergétique résidentielle Un examen de la consommation d’électricité dans le secteur résidentiel nous permet de constater une tendance croissante de la demande en énergie depuis environ 2016. En 2019, la demande d’électricité au pays s’est chiffrée à 625 060 térajoules, ce qui indique une hausse qui coïncide avec la proportion croissante de VZE sur le marché canadien. En 2017, les VZE représentaient 1,0 % des immatriculations de véhicules neufs au Canada, une croissance qui a plus que décuplé pour atteindre 10,3 % au cours des trois premiers trimestres de 2023. La plupart des gens rechargent leur VZE à la maison, principalement en dehors des heures de pointe, lorsque la demande en électricité est moindre. Cette intégration dans les routines résidentielles contribue à l’augmentation de la consommation d’électricité dans le secteur résidentiel. Bien qu’il existe un lien entre la demande croissante d’énergie résidentielle et l’utilisation des VZE, d’autres facteurs liés à l’augmentation de la consommation d’énergie, tels que la croissance démographique et l’augmentation du nombre de logements, doivent être pris en compte. Demande par province Au cours des dernières années, le Québec, l’Ontario, la Colombie-Britannique et les territoires étaient à la tête de la représentation des VZE au Canada; ils étaient à l’origine de 92,2 % des nouvelles immatriculations de VZE de 2018 à 2022. En adoptant une perspective régionale, il est possible de mieux observer l’incidence des VZE. Bien que la demande en énergie résidentielle de certaines provinces soit en stagnation, la Colombie-Britannique a connu une croissance constante, passant de 69 962 térajoules en 2018 à 78 082 térajoules en 2022. En 2018, les VZE représentaient 0,5 % (14 773 véhicules) des véhicules légers immatriculés qui circulaient sur les routes de la Colombie-Britannique, et ce chiffre a augmenté pour atteindre 2,8 % (91 528 véhicules) en 2022. L’Alberta, pour sa part, s’est classée au deuxième rang des plus fortes hausses en pourcentage de 2018 à 2022 en ce qui concerne la demande en énergie résidentielle. Cependant, au chapitre de l’immatriculation des VZE dans les provinces, l’Alberta s’est retrouvée au bas de l’échelle; les VZE représentaient 0,3 % du nombre total des immatriculations de véhicules légers dans cette province. Prévisions et contraintes énergétiques En 2022, la production totale d’électricité au Canada s’est chiffrée à 636,2 millions de mégawattheures (MWh), ce qui représente une augmentation de 1,3 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse devrait se poursuivre en raison des besoins croissants en électricité au pays. Comme la réglementation prévoit que les VZE représenteront une plus grande part des ventes de véhicules neufs au cours de la décennie qui précédera l’an 2035, il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’il y ait 10 millions de VZE sur les routes d’ici là, si l’on se fie aux 24,8 millions de véhicules légers et moyens qui ont été immatriculés à l’échelle nationale en 2022. La plupart des VÉ actuellement offertes sur le marché consomment environ 3000 à 6000 kilowattheures (kWh) par année pour chaque tranche de 20 000 km de conduite, un intervalle qui dépasse sensiblement la consommation annuelle d’un nouveau réfrigérateur (environ 500 kWh par an), selon la Régie de l’énergie du Canada (REC). En tenant compte de ces chiffres, la consommation supplémentaire de 10 millions de VÉ serait de 30 à 60 millions de MWh, soit 4,7 % à 9,4 % de la production d’électricité en 2022. Le mélange énergétique diversifié du Canada Alors que le Canada se dirige vers l’adoption généralisée des VZE, le secteur de l’énergie doit composer avec une nouvelle série de défis et de possibilités. En 2022, la majeure partie de l’électricité était produite à partir de turbines hydrauliques (61,9 %). Le reste était produit à partir de combustibles (18,7 %) ainsi que de sources nucléaires (12,9 %), éoliennes (5,7 %) et solaires (0,6 %). Grâce au mélange énergétique diversifié du Canada ainsi qu’à sa volonté d’abandonner les combustibles pour miser davantage sur la production d’énergie renouvelable, le pays est en bonne posture pour gérer les besoins énergétiques qui pourraient découler de l’adoption accrue des VZE. Toutefois, la Régie de l'Énergie du Canada prévoit que les variations régionales de la production d’énergie, telles que la production prédominante d’énergie hydroélectrique dans certaines provinces et la dépendance aux combustibles fossiles dans d’autres, nécessitent l’adoption de stratégies personnalisées en matière de réduction des émissions. StatsCAN Contribution: André H. Martel
Commentaires
|
Abonnez-vous à notre infolettre hebdomadaire
Use a valid e-mail address Votre inscription est confirmée.
xhr
100
NOS PARTENAIRES |
|
Association des Véhicules Électriques du Québec
|